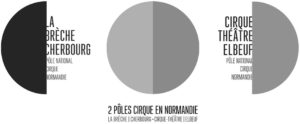Une précaution s’impose : quand on parle de performance, ce n’est pas au sens sportif du terme, la forme performative n’est pas la prouesse.
C’est une des voies les plus récentes du cirque actuel et ce n’est pas un hasard, la danse comme le théâtre ont aussi réactivé la performance, qui est toujours le signe d’un désir de pousser plus loin les limites ou les esthétiques.
Dans le champ de l’art, la performance a pris naissance en Europe avec les Futuristes dans les années 30, le mot indiquait une volonté de s’affranchir du passé pour s’inscrire en rupture avec la tradition. Avec le temps, de nouvelles formes ont surgi. La performance est aujourd’hui en quelque sorte une anti-discipline dans laquelle l’artiste prend son corps comme matériau de création.
Les formes performatives refusent les codes spectaculaires au nom d’un engagement du corps pour réaffirmer ce qui fut l’essence de la performance : l’abolition des frontières artistiques, mais aussi la dilution de l’art dans la vie. Mais cet « ici et maintenant » qu’exige le genre a perdu avec le temps de son intransigeance : l’improvisation n’est pas toujours de mise et l’expérimentation n’empêche pas de multiplier les représentations. Au point que l’on classe trop souvent sous le vocable ce que l’on ne sait justement pas classer. Mais peu importe. L’essentiel aujourd’hui semble de faire expérience « avec » le spectateur et non « pour » lui semblent dire tous ceux qui cherchent dans la confrontation et la déstabilisation, une nouvelle manière de vivre leur art dans une économie de moyens qui la rendent assez facilement perceptible : pas de décors, peu d’objets, l’épure en tout.
Il y a autant de performances qu’il y a de performeurs a écrit fort justement l’artiste pluridisciplinaire québécois Rober Racine, autant dire que les tendances n’y sont pas de mise et qu’il nous faut donc citer ces performers pour circonscrire le champ.
On pourrait parler d’art action ou de cirque pur pour le collectif XY ou de Un loup pour l’Homme. Ces artistes creusent le geste pour le geste acrobatique loin des influences des autres arts. Parfois, c’est dans le propos que la performance se niche. Fragan Ghelker dans son essai Le vide, explore un seul geste : tenir sur une corde lisse et cherche toutes les issues pour échapper à la fatalité de la chute. Plus en phase avec nos enjeux contemporains sur la relation au vivant, la suspensive Chloé Moglia s’agrippe à de longues lignes d’acier, attentive aux micros gestes que le mouvement nécessite. Elle vient du trapèze et du systema (art martial), deux disciplines qui ont forgé sa pratique de la suspension. Son art requiert une attention au poids, à la légèreté, au temps dilaté, socles de ses spectacles ou de ses performances. Nourrie des lectures d’Emanuele Coccia, Baptiste Morizot, ou Philippe Descola, sa démarche devient écologique invitant à ralentir, très loin de nos vaines agitations terrestres. Dans ce même souci environnemental, Cyril Casmèze acrobate zoomorphe, se transforme en singe, en chien ou en ours, par mimétisme et c’est saisissant. Ex-cirque Plume, où il incarnait l’animal de cirque, il a créé la compagnie du Singe debout avec la comédienne et metteuse en scène Jade Duviquet, dans laquelle il interroge notre rapport homme-animal qu’il décline en performances, conférences ou spectacles.
Proche du land art, Laurent Channel a créé sa compagnie ARN en 2011. Il est issu du cirque et joue aujourd’hui avec nos perceptions de la gravité et des mouvements qui littéralement nous animent, créant des dispositifs qui les rendent perceptibles. Sa grammaire bien que nourrie de cirque, s’étend au cinéma, aux sciences et aux territoires d’altitudes. Il déploie différents formats : sculptures chorégraphiques, rites (il trace des cercles de marche des heures durant), laboratoires autour des États Modifiés de Gravité…
Autres marcheurs, les 6 jongleurs du collectif Protocole ont inventé le bien-nommé Périple 21, avalant six mois non-stop des milliers de kilomètres avec un ou une invitée chaque fois différent.e. Seules les massues font l’intégralité du voyage, les marcheurs se relayant, leur enjeu étant dans la marche, la rencontre, le relais, pas le jonglage de ses massues…
Dans la veine bidouille et autres bricolages, on peut citer l’italo-belge Claudio Stellato (Work) qui rend le bricolage spectaculaire, armé de bois, d’outils ou de clous, à grand renfort de bruits et de gestes pour faire dialoguer le corps et la matière. Phia Ménard (Maison mère) construit à grand peine un Parthénon de carton pré-découpé, armée de quelques cales et d’un rouleau de scotch, dont elle découpe des morceaux à dents nues, ne ménageant pas sa peine, même si à mesure qu’il se construit, l’édifice menace de rompre sous l’assaut d’une pluie torrentielle. Aux antipodes de cette performance pour grand plateau, Rémi Luchez (Miettes) se promène sur un fil de fer instable posé entre deux branches, tel un clown qui tente de tenir en équilibre avant de couper au sécateur le fil qu’il a péniblement gravi. Aucune prouesse, être là dans l’instant, partager des émotions minuscules, tel semble être le propos de Miettes, et pourtant on en sort hypnotisé.
Que reste-t-il du cirque chez tous ces performers ? Le geste bien sûr, tendu, trituré, exploré à l’extrême pour y laisser advenir tout ce que la prouesse masquée par la virtuosité peine souvent à raconter.